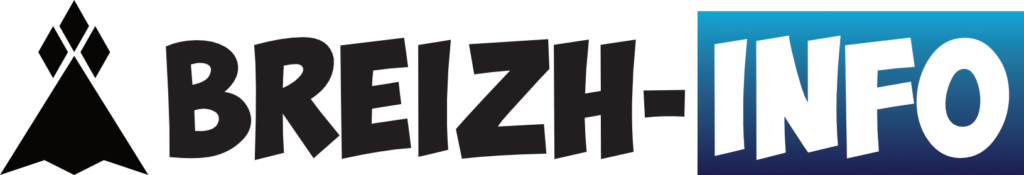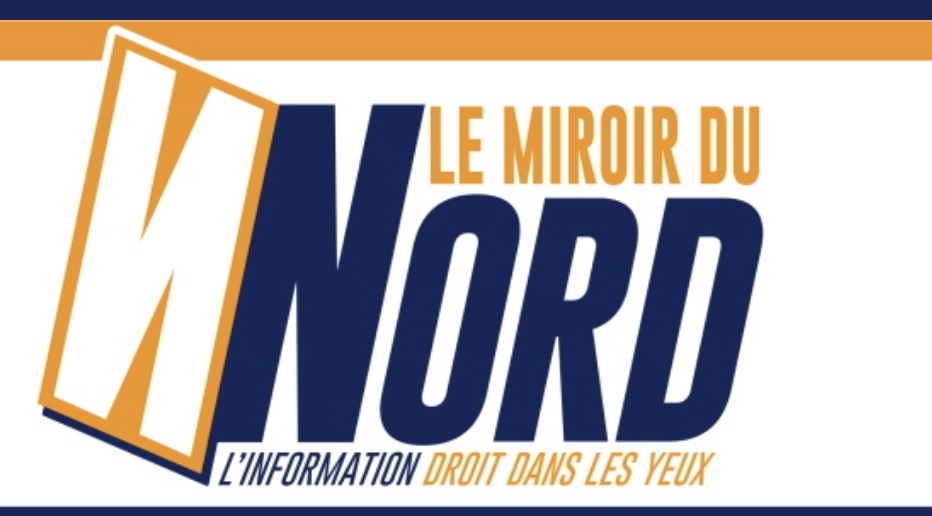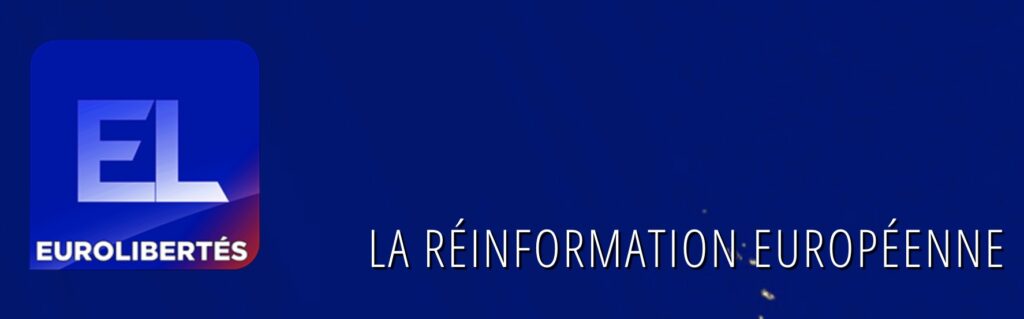André Murawski, le numéro 3 de la revue Caritas vient de paraître. Comment êtes-vous devenu rédacteur en chef de ce trimestriel ?
La dissolution du parti politique Civitas par décret du 4 octobre 2023 a entraîné l’arrêt de toutes les activités politiques et militantes de ce parti, ainsi que la fin de la publication de sa revue dont le titre était aussi Civitas. Contrairement aux allégations d’une certaine presse, la revue Civitas ne s’est pas « transformée » mais a disparu. C’est pour répondre à l’attente d’un public de catholiques de Tradition, mais aussi de lecteurs qui, sans être nécessairement catholiques, s’intéressent à la doctrine politique et sociale de l’Eglise qu’une nouvelle revue a été lancée en 2024 : la revue Caritas.
Après les élections européennes de 2024, j’ai été sollicité par la revue Caritas pour commenter le résultat de ces élections pour la France. Cette interview prenait place aux côtés de celles d’Alain Escada pour la Belgique, Andrea Giacobazzi pour l’Italie, John Mc Auley pour le Royaume-Uni, Xavier Moreau pour la Russie, Stanislaw Rajewski pour la Pologne et Alain Späth pour la Suisse. Fidèle à sa ligne catholique, la revue abordait l’actualité politique sous un angle européen transnational.
C’est après cette collaboration qu’il m’a été proposé de succéder au Professeur Hugues Petit dans le fauteuil du rédacteur en chef. L’objectif qui m’a été assigné consistait à poursuivre l’excellent travail de mon prédécesseur tout en faisant évoluer la revue. Pour la parution du numéro 3, la pagination a un peu augmenté et j’ai souhaité ajouter une rubrique répondant à la question « que faire ? » afin de présenter aux lecteurs des activités dans lesquelles ils pourraient s’engager très concrètement au service de leurs convictions et d’une « certaine idée » de la société française aujourd’hui.
Le dossier du 3e numéro de Caritas est consacré au thème : Satanisme et mondialisation. Pourquoi avoir choisi de parler du satanisme ?
D’abord parce que ce sujet est, si j’ose ainsi m’exprimer, d’une brûlante actualité. Pour la plupart des gens, le satanisme ne se manifeste plus que dans le cinéma d’épouvante ou dans des pratiques marginales un peu folkloriques. Or, cette opinion est erronée. En effet, non seulement des pratiques sataniques existent toujours comme le montrent par exemple les profanations d’églises ou de cimetières, mais le satanisme se manifeste également à travers des projets « sociétaux » visant à déshumaniser l’homme pour le réduire à l’état de chose.
Cette réification de l’homme a d’abord été dissimulée sous le couvert rassurant de la recherche médicale disculpée par des sentiments d’humanité pourtant contraires à l’éthique. Ainsi, l’avortement a été légalisé pour répondre à des situations de détresse. Mais il a vite dérivé vers un prétendu « droit » qui a été étendu peu à peu à tous les cas de figure. En France, il a même été inscrit dans la Constitution alors que rien ne le justifiait. Toujours sous prétexte médical, c’est à présent l’euthanasie et le suicide assisté qui sont en projet. Concernant le déroulement de la vie, la recherche est activement poursuivie pour « augmenter » la durée de l’existence tout en améliorant les performances humaines par des moyens techniques. Ici encore, les chemins de l’enfer sont pavés de bonnes intentions et nul ne semble songer à ce que celui qui contrôle la technique contrôlera bientôt l’homme « augmenté », réduit à l’état d’objet, et d’objet utilitaire bien évidemment. L’homme augmenté sera un homme réduit en esclavage.
D’aucuns diront peut-être que les évolutions de la bioéthique sont inéluctables, et qu’y voir du satanisme ne relève que de l’imagination. Mais pourquoi les manifestations sataniques sont-elles alors passées de la discrétion au grand jour, et cela au niveau mondial, en tout cas dans la partie occidentale du monde ? La cérémonie d’ouverture des jeux olympiques de Londres, en 2012, a montré la figure de Voldemort, sorcier maléfique. En 2016, c’est la cérémonie d’inauguration du tunnel du Gothard qui a mis en scène le diable sous la forme d’un bouc. En 2022, la cérémonie d’ouverture des jeux du Commonwealth a expressément fait référence au veau d’or et au rituel de Baal. En 2023 aux Etats-Unis, Sam Smith et Kim Petras ont appelé la jeunesse à « vénérer satan » pendant les Grammy Awards. Cette accumulation accélérée de références explicitement sataniques a connu un nouveau sommet lors de la cérémonie d’ouverture des jeux olympiques de Paris en 2024, au point que la retransmission en a été – au moins partiellement – censurée dans 130 pays sur les 193 qui existent dans le monde.
Après « satanisme et mondialisation », quel sera le dossier traité dans le prochain Caritas ?
Le prochain dossier abordera un sujet à la fois économique et sociétal, puisqu’il étudiera l’agriculture du futur, entre mondialisation et localisme. La question de l’agriculture a récemment fait l’actualité puisqu’en novembre 2024, l’accord de libre échange entre l’Union européenne et les pays du MERCOSUR a provoqué la colère des agriculteurs français. Cette nouvelle étape vers la mondialisation complète des échanges entre l’Union européenne et le reste du monde pose de nouveau la question de la concurrence déloyale que se livrent des pays dont les niveaux de vie et les coûts de production sont trop dissemblables.
Au-delà des questions économiques stricto sensu se profilent cependant des problèmes éthiques et politiques. Sur le plan éthique, peut-on importer des produits dont les cahiers des charges sont moins sévères par exemple en termes de normes environnementales et sociales ? Sur le plan politique, est-il raisonnable d’accepter une spécialisation de la production agricole au risque de l’insuffisance alimentaire de la France ? La crise du covid-19 a montré notre dépendance complète de l’étranger en matière de production, au point qu’on a commencé à évoquer une réindustrialisation. Quelle serait la souveraineté réelle de la France si elle n’était pas autosuffisante pour nourrir sa population ?
Face aux enjeux posés par le commerce international, une riposte est cependant timidement esquissée. La démarche réside dans une production reposant à la fois sur la qualité, par exemple avec les filières de l’agriculture bio ou de l’agriculture raisonnée, et sur la proximité. Le localisme agricole est vertueux sur le plan de l’environnement. Il privilégie une démarche de qualité des produits, mais aussi de qualité du travail et donc, à terme, l’emploi local. Il assure à la population l’accès aux produits locaux et de saison, tissant à nouveau le lien entre l’homme et son écosystème. Enfin, en nourrissant la population, le localisme participe à l’indépendance et à la souveraineté nationales. Un beau dossier en perspective !
Pour s’abonner à la revue :https://medias-culture-et-patrimoine.com/products/4087