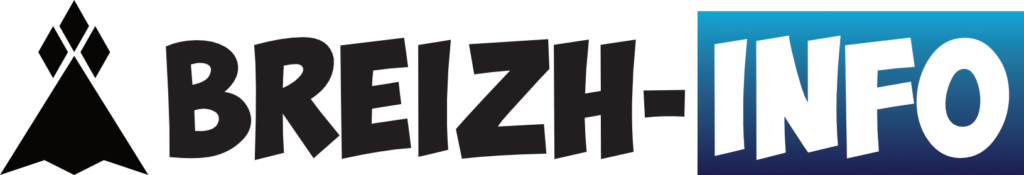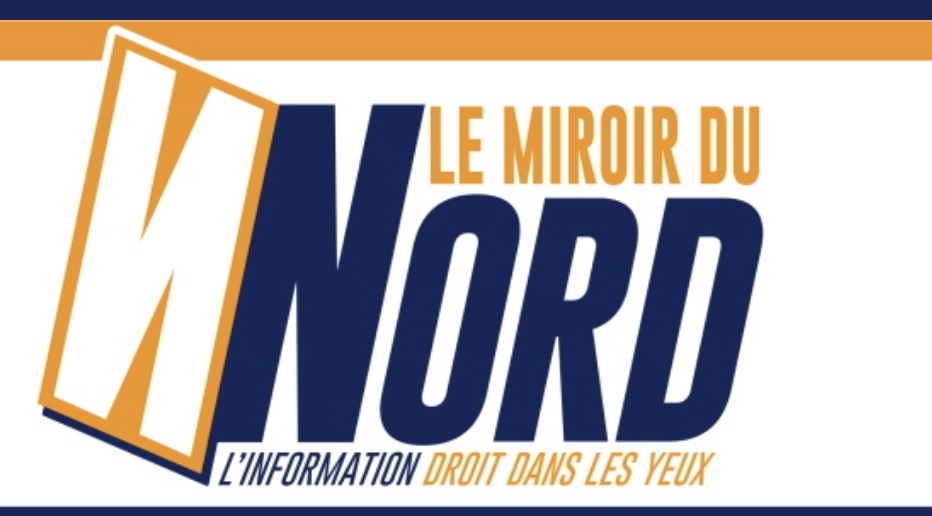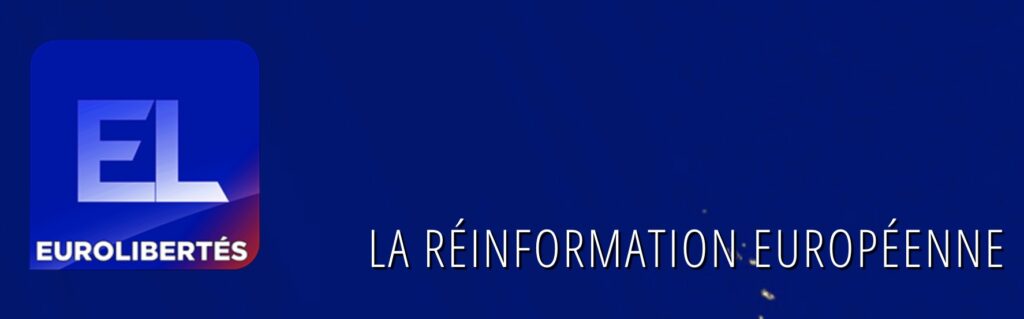Les défaillances d’entreprise ont atteint dans la restauration un niveau historiquement élevé. Rien qu’en Île-de-France, au dernier trimestre 2024, le nombre de dépôts de bilan a augmenté de 40% sur un an. D’après l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih) pour Paris et l’Île-de-France, « nationalement, il y a 15 à 20 restaurants qui ferment tous les jours ».
Les difficultés s’accumulent : inflation, remboursement des prêts garantis par l’État (PGE), changement des modes de consommation depuis l’avènement du télétravail, hausse des livraisons à domicile, limitation drastique des dépenses dites « superflues » par nombre d’anciens clients en raison d’un pouvoir d’achat subissant une cure d’amaigrissement forcée, etc.
Au-delà de ces motifs conjoncturels pour certains, structurels pour d’autres, quelles autres explications est-il possible d’avancer pour comprendre un désintérêt sans cesse plus grand des Français pour le « resto » ?
Petit tour d’horizon.
Comme depuis plusieurs étés désormais, le secteur de la restauration déplore des chiffres en berne, une fréquentation des établissements en baisse, des tables laissées vacantes et des couverts attendant désespérément un client.
Une première explication immédiate, intuitive et parfaitement exacte d’un porte-monnaie toujours moins rempli pour les couches populaires et les différentes strates de ce qu’il est convenu de nommer par facilité la classe moyenne vient à l’esprit. Ceci, en raison de l’augmentation des dépenses incompressibles (nourriture, logement, carburant, énergie) et limitant de façon mécanique les dépenses de loisirs et les « petits plaisirs ». Mais d’autres raisons permettent d’éclairer ce désamour grandissant des Français pour le « resto ».
Dégradation de la qualité de la cuisine et du service
Principale raison : la dégradation constante, dans moult établissements, depuis de nombreuses années, du service et des prestations offertes.
En effet, entre les portions parfois faméliques, l’abus de plus en plus mal masqué du « sous-vide » voire du surgelé, l’amabilité optionnelle notamment dans les zones les plus touristiques, le sourire en supplément au même titre que la portion riquiqui de haricots verts ou le ramequin minuscule de gratin dauphinois sans oublier la « globalisation » grandissante de la cuisine française (ah! l’inévitable burger décliné à toutes les sauces), il est logique que les Français ne se précipitent plus guère dans ce qui fut naguère des temples de la gastronomie française.
Ajouter à cela, ces deux trous noirs de la restauration que l’on pourrait qualifier d’intermédiaire
(i.e entre la modeste brasserie de quartier et l’étoilé au Michelin), à savoir : le plateau de fromages et la farandole des desserts. Plutôt que de plateau, il vaudrait mieux parler de bûchette et en guise de farandole c’est plutôt à un menuet discret auquel le client a droit. Entre les trois ou quatre fromages sans originalité (en France, pays dans lequel on dénombre entre 1200 et 1600 variétés de fromages!) et l’inévitable crème brûlée ou l’île flottante qu’il faut généralement observer avec une loupe, il est logique que nombre de Français boudent les restaurants, et ce, d’autant plus au regard d’une note parfois très salée.
Il serait d’ailleurs intéressant d’avoir un bilan détaillé effectué par un organisme indépendant sur le respect des trois engagements pris par le secteur de la restauration sous Sarkozy après avoir obtenu la baisse de la TVA (1). Pour rappel, ces trois engagements étaient : baisse des prix à la carte, augmentation des salaires des employés et de nouvelles embauches. Un quatrième critère était généralement avancé : une modernisation de l’équipement. Un rapport complet et exhaustif sur le sujet ne manquerait, à n’en pas douter, de livrer quelques (désagréables) surprises…
Autre motif qui agace légitimement nombre de Français : la restauration en compagnie de l’hôtellerie et du BTP (les trop fameux « métiers en tension ») est le secteur au sein duquel le patronat (coucou Thierry Marx…) n’a de cesse de réclamer toujours plus de main d’œuvre issue du Tiers-Monde. La présence d’un personnel indo-pakistanais ou subsaharien (pas toujours déclaré) dans les cuisines des restaurants traditionnels est devenue une source intarissable de plaisanteries faciles mais aussi parfois de colère de moins en moins rentrée contre ce secteur économique.
Enfin, il est assuré que nombre de Français n’ont pas effacé de leur mémoire les choix de nombre de restaurateurs durant la séquence covid-19. Entre leur incapacité à s’organiser pour désobéir aux injonctions gouvernementales pour rouvrir leurs établissements malgré les fermetures imposées (on ne reviendra pas sur les gesticulations pitoyables de l’inénarrable Stéphane Manigold) et leur zèle insupportable, digne des policiers les plus obtus, à contrôler l’infâme passe sanitaire, on comprend aisément que nombre de Français ont peut-être pardonné mais certainement pas oublié cette attitude collaborationniste (2).
Inutile de tourner autour du pot : les restaurants sont trop nombreux en France et le marché dans ce secteur est peut-être en train de s’auto-corriger. Il faut souhaiter qu’au final ne resteront que les restaurants embauchant plutôt Matthieu et François que Mamadou et Imran, respectant leur clientèle (les établissements attachés sincèrement au « fait maison » et aux « produits frais » par exemple), n’arnaquant pas les touristes en leur faisant payer des produits non commandés, en gonflant les prix, ou en doublant la quantité de plats et boissons commandés (« bill padding »), sans omettre ceux qui, contrairement à d’autres, n’ont pas pris un plaisir sadique à refuser les opposants à la ségrégation sérologique mise en place durant l’épisode de dressage social connu sous le nom de « pandémie de coronavirus ».
Maurice Gendre
(1) Selon une étude de l’Institut des politiques publiques (IPP), un établissement spécialisé dans l’analyse et l’évaluation des politiques publiques, rendue publique en 2018, et opportunément accusée de partialité, cette baisse n’aurait bénéficié qu’aux restaurateurs. Les patrons de restaurants auraient capté 55,7 % des gains réalisés, bien davantage que les 33% qu’ils étaient censés obtenir. De quoi ainsi augmenter de 24% leur bénéfice. Les salariés n’auraient eux bénéficié que de 18,6 % de la baisse, soit une augmentation moyenne de 4,1% du coût des salaires. Quant aux clients, ils n’auraient profité que de 9,7% des gains enregistrés, soit une baisse du prix de l’assiette de…1,9%. “L’effet sur les consommateurs a été limité”, précisaient alors les économistes avec un goût appuyé de la litote.
(2) A la décharge des restaurateurs, des millions d’autres Français ont été incapables de désobéir durant le funeste épisode covid.
Vous aimez nous lire? Faites un don, vous êtes nos seuls soutiens!