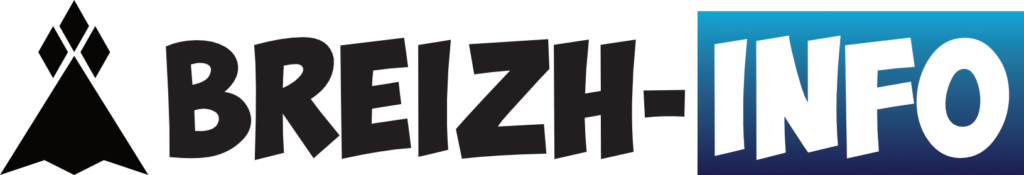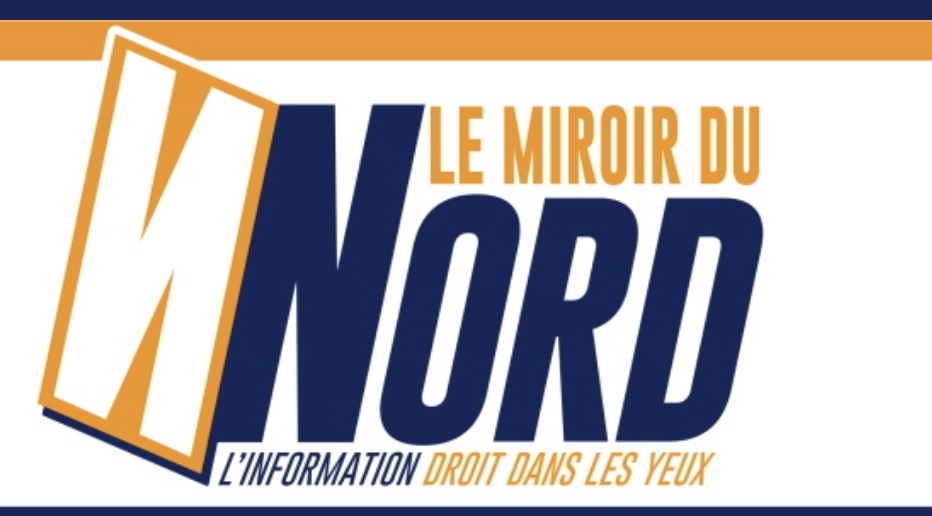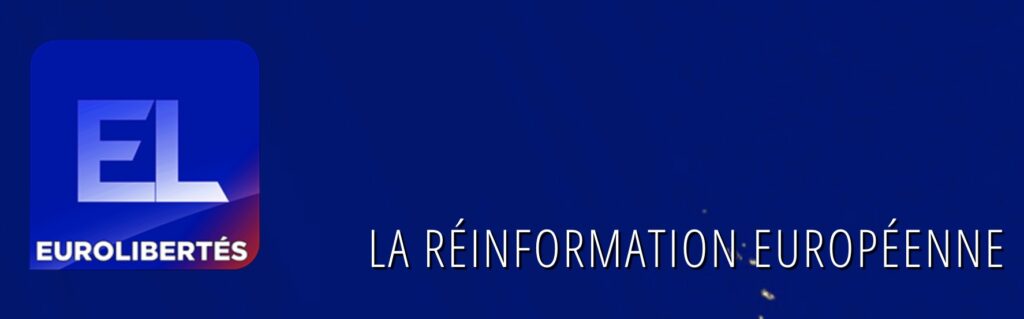«Jadis aux enfers, Certes, il a souffert, Tantale, Quand l’eau refusa / D’arroser ses amygdales… Etre assoiffé d’eau, C’est triste mais faut Bien dire / Que l’être de vin, C’est encore vingt fois pire », chantait tonton Georges…
Les chantres de Noé, de Dionysos, de Bacchus, tels justement Brassens et son ami René Fallet à qui nous devons Le beaujolais nouveau est arrivé, roman drôle, décalé, assurément poétique… Sans oublier Baudelaire, Antoine Blondin, Jean Carmet qui disait que son arme préférée était le tire-bouchon, les Dumas, père et fils, Kléber et son épouse Caroline, la maitresse-queux Colette, Simenon et Maigret, ni Léon Daudet qui assénait : « L’eau, triste dans le verre, est sinistre dans le plat », se lécheront les babines à la simple évocation du nom de cette cité pierreuse, poudreuse, pentue, ensoleillée et vineuse à souhait autant que médiévale. Elle arbore sur son blason les lys royaux et les lions léopardés normands, à la ville comme à la campagne et bien légitimement sur les vitraux de son église. Cette dernière est érigée au beau milieu du village circulaire, fortifié en rondes défensives sous la férule de Jean Sans Terre et dont le centre est culminé par une tour cubique qui donne le tournis par sa hauteur, tout pareillement aux liqueurs du pays par leur ardeur alcoolique. Au faîte de la ville, le roi Henri III, seigneur d’Irlande et duc d’Aquitaine, ordonna en 1237 sa construction. Aussi l’appelle-on aujourd’hui tout bonnement la Tour du roi.
Les Béraud, père et fils préféraient le beaujolpif et tout particulièrement le juliénas, Brasillach, Brassens et Bobby Lapointe les vins du pays de l’Aude, du Languedoc, du Roussillon, tandis que Pierre Desproges ne jurait que par ceux de Bordeaux. Saint-Émilion, c’était son vin, à ce que l’on dit. Il le cite souvent dans ses chroniques et plus particulièrement un château et un millésime : Figeac 1971.
N’en déplaise à Monsieur Cyclopède, j’ai pour ma part conservé une tendresse particulière pour le château d’Yquem 1969. Un vin d’à côté, coté à trois-cent-nonante-et-un euro la flasque aujourd’hui ! Dieu sait si j’en ai bu, de bon matin, de conserve avec le vaguemestre, quand j’étais encore un peu adolescent, sans savoir ce que je faisais, sur le compte de mon directeur et ami qui se moquait de moi quand je trouvais benoîtement, que c’était comme du porto ! Blasphème, sacrilège, impiété pardonnés dans le rire sonore de ce sâcro à l’ovrâdzo, comme on dit en patois vaudois, Claude Nobs qui bénéficie aujourd’hui à Montreux, par-delà la mort, d’une belle avenue à son nom, bien méritée.
Finistère, Dordogne & histoires de falaise et de Falaise…
Le fleuve commence à finir sa course ici, en limite sud-ouest de la ville. A Blaye, face au Bec-d’Ambès, il entre en confluence avec la Garonne. Il est large et parsemé d’îlots entre lesquels circulent des bacs à fond plat et à faible tirant d’eau. Plus loin, c’est l’océan que l’on ressent déjà, sa puissance, son orgueil, sa violence, son vent et son sel, il nous nargue de loin, nous affronte et nous appelle à la fois, à la foi, terriens que nous sommes, qui chérissons et craignons la mer. Un oppidum gaulois et une villa gallo-romaine attestent du dévouement très ancien à la vigne et à la viticulture. Mais c’est un moine breton, Émilion le généreux, natif de Vannes qui honorera de son nom, à jamais, celui de la cité en s’installant dans une grotte des hauts de la Dordogne.
Ses fidèles entreprirent après sa mort en 767, de creuser une église monolithe extraordinaire jamais représentée en Europe à cette échelle, dans la masse du rocher calcaire près de laquelle une falaise a été aménagée en catacombes et où s’écoule une source miraculeuse, mais ne le sont-elles pas toutes en vérité ?
En 1199, Jean Sans Terre succède à son frère Richard Cœur de Lion sur le trône d’Angleterre. Le 8 juillet, il signe à Falaise une charte confirmant les privilèges, franchises et libres coutumes accordés à Saint-émilion. En créant la Jurade, ce roi met en place les moyens locaux de résistance au pouvoir religieux et à la noblesse. Par cette sorte de marché, Albion put bénéficier du « privilège des vins de Saint-Émilion ». De père en fils et de fil en aiguille la superficie du vignoble augmenta tout comme la notoriété de ses breuvages dont la qualité était soumise au contrôle de la Jurade par le sceau du vinettier avant chargement vers l’Angleterre depuis le port de Pierrefitte voisin. L’empire de la Jurade verra sa fin en 1789 mais retrouvera un semblant de couleur en 1948 sous la forme d’une confrérie toujours vivante autant que pittoresque et littéralement réactionnaire, qui organise des manifestations, des messes et banquets où l’on ne consomme guère de ces salades de quinoa et d’épeautre si convenables aux « hommes déconstruits », mais des boudins dorés, des porcelets dodus rôtissant sur un lit de braise rougeoyante, épaisse et dense comme un matelas d’auguste famille.
Des flèches qui ne doivent rien à Cupidon
On ne peut s’empêcher en parcourant la ville, de songer à la guerre de Cent Ans, si prégnante par les murs, les murailles et leur calme murmure. Aux Normands alliés des Anglois et à Robin des bois de nos contes de jeunesse… Aux archers ennemis lâchant sans cesse dans l’air des essaims d’aiguilles meurtrières et perfides qui noircissaient le ciel comme le ferait une éclipse solaire. Entendez-vous, vous aussi, le sourd bourdonnement céleste, effroyable et terrible qui précède la malemort des hommes nobles, ou roturiers et de ces pauvres bêtes de somme qui, pour ces dernières, n’avaient rien demandé à personne ?
Les drones aujourd’hui remplissent la même tâche, avec le même succès, dans cette guerre larvée menée ouvertement par l’état profond américain, Sleepy Joe Biden, vieillard sénile régnant, la CIA, le MI6, l’OTAN et ses laquais… contre la Sainte Russie en sacrifiant cette pauvre Ukraine, sa jeunesse et presque toute son espérance de survie. Les véhicules aériens sans pilote (VAP ou UAV) pulvérisent les véhicules de l’avant blindés (VAB), les chars légers, moyens ou lourds, les systèmes de défense antiaérien et les canons automoteurs d’artillerie, comme les dards anglois ont vaincu la cavalerie française à Crécy, sans trop se mettre en danger. L’Histoire ne se répète pas, une fois de plus elle bégaie.
Pardonnez-moi, prince si je suis foutrement moyenâgeux…
A Saint-Émilion, quand on s’approche de l’immense tour, si l’on a un peu d’imagination et de fraîcheur d’esprit ou d’intensité émotive, on entend pour de bon claquer les bannières au grand vent et sonner l’olifant. On a peur des bruits d’armure, du goût et de l’odeur du sang, et du son lancinant des pas des chevaux qui précède celui des marteaux à la mauvaise heure de l’hallali. Les cliquetis d’épées, le crissement des flèches sur les côtes de maille crevées à cause d’une improbable faille. La Camarde peut agir d’un simple glissement de dague dans l’œil, par un coup habile sous le casque. Ou l’anéantissement d’un cheval lourd, qui coûte une fortune comme son équipage et qu’une flèche pesant à peine cent gramme, coûtant trois sols, ajustée par un gueux briton, habitué à une cadence de tir de douze seconde va toucher et vaincre. Oh oui ! La mort chevauchait à travers le pays, frappant sans choix les héros, les bannis… Nous autres face à elle n’avons de regrets, failalala ! Mais puisque nous vivons, grâce à Dieu, promenons-nous sur les remparts qui sont d’autant plus intéressants qu’ils sont bien conservés.
De son enceinte du XIIIème siècle, renforcée par suite d’un chemin de ronde, Saint-Émilion profite encore de la moitié de ses fortifications d’antan, de créneaux, de meurtrières et autant de mâchicoulis que de portes. D’ailleurs, un jour, sept cavaliers quittèrent la ville au crépuscule par la porte de l’ouest qui n’était plus gardée… Salut à Jean Raspail !
D’un château, l’autre.
La guerre de cent ans s’est terminée tout à coté, à Castillon-la-Bataille, par une victoire franque le 17 juillet 1453. La première bataille terrestre ayant eu lieu à Saint-Omer le 26 juillet 1340, conclue par une victoire franque aussi. Si vous passez par là, profitez de ces saveurs et paysages et continuez votre chemin oenologique en passant par Pauillac, Blaye, Bordeaux, Pessac jusqu’au château de Roquetaillade qui semble un décor de cinéma où l’on ne serait pas étonné de rencontrer quelques guetteurs royaux ou autres « visiteurs » comme Jacquouille la Fripouille, fidesle escuyer du comte Hubert de Montmirail dont la devise était : « Montjoie ! Saint-Denis ! Que trépasse si je faiblis ! ».
Franck Nicolle