Dans son numéro de rentrée, le trimestriel Liberté Politique consacre un dossier fouillé et largement documenté à la situation financière de l’Église de France. Et ce n’est pas très brillant… Entre mauvaise gestion, opacité, scandales divers, tensions internes et dons en berne, les diocèses de France sont-ils au bord de la faillite ? Nous avons interrogé Olivier Frèrejacques, rédacteur en chef de la revue et initiateur de ce dossier.
– Tout d’abord, comment vous est venu l’idée de ce dossier sur la situation financière de l’Église de France ?
Cette enquête est la deuxième de ce type que nous avons réalisée. Comme en 2023 pour la première édition, nous avons choisi de nous pencher sur un aspect concret de la crise de l’Église : un sujet non pas théologique, dogmatique ou canonique, mais financier et palpable.
Les églises en décrépitude constituent la partie visible du déclin du catholicisme en France. Cependant, derrière ces pierres abandonnées se profile un abandon de la pratique religieuse, qui a des conséquences pratiques évidentes pour l’institution ecclésiale.
– Comment avez-vous procédé pour mener cette enquête? Les instances de l’Église se sont-elles montrées collaboratives ?
En 2023, pour recueillir les données sur le denier de l’Église, nous avons tenté de contacter directement chaque diocèse français par téléphone ou par courriel, mais cette méthode s’est révélée peu efficace. De nombreux diocèses étaient injoignables ou refusaient de communiquer leurs chiffres, témoignant d’un manque de transparence. Pour y remédier, nous avons analysé les comptes des associations diocésaines publiés au Journal officiel. Ces comptes fournissaient parfois des données détaillées sur le denier, mais celles-ci étaient souvent agrégées avec d’autres « dons manuels ». Bien que plus fructueuse, cette approche a été affinée en 2024 en privilégiant pappers.fr, un site d’information légale, juridique et financière créé en 2020, car les comptes étaient rarement disponibles au Journal officiel. Comme en 2022, de nombreux diocèses omettent de publier le montant précis du denier, et la présentation des comptes varie selon les cabinets comptables ou les années. Ce manque de clarté rend notre tableau de données incomplet, révélant une opacité persistante. Certains diocèses compensent cette lacune par des campagnes médiatiques mettant en avant leurs difficultés financières et la baisse du denier. Nos analyses reposent sur environ un tiers des chiffres disponibles et sur les communications officielles, malgré ces contraintes.
– Sans dévoiler, bien sûr, l’ensemble de ce passionnant dossier, pouvez-vous brosser à grands traits le constat qu’il vous a permis de faire ?
Le constat est alarmant. En 2023, le denier de l’Église se portait bien, mais cette situation s’expliquait par un phénomène de compensation dans le contexte de la crise sanitaire. Les donateurs catholiques, plus généreux, ont compensé l’absence de quêtes, interrompues par la fermeture des églises, en augmentant leurs contributions au denier. L’Église a également bénéficié d’une déduction fiscale temporaire, passée de 66 % à 75 % pour cet exercice.
En 2025, on observe une chute significative du denier, une tendance qui devrait se prolonger avec le vieillissement des fidèles. La fermeture des églises a entraîné une perte de pratiquants, particulièrement marquée dans les campagnes, où l’hémorragie de la pratique religieuse conduit à des regroupements de paroisses. Le tableau n’est guère plus encourageant en milieu urbain : dans les quatre premières villes de France (Paris, Lyon, Marseille et Toulouse), le denier est en baisse. En revanche, les diocèses d’Île-de-France, hors Paris, se portent bien.
– Quels sont, selon vous, les principales raisons de la baisse des montants du « denier de l’Église » ?
Le principal facteur de la baisse du denier est sans doute le vieillissement de la population pratiquante. La diminution de la pratique religieuse, particulièrement marquée après la crise sanitaire, a également pesé sur les contributions.
Les scandales d’abus sexuels ayant ébranlé l’institution, ainsi que leur gestion calamiteuse avec le rapport Sauvé, ont probablement contribué à cette baisse. Les tensions entre certains évêques et les catholiques traditionalistes ou jugés trop conservateurs ont pu accentuer ce désengagement. Enfin, les communautés et fraternités indépendantes des diocèses, telles que la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre ou la Communauté Saint-Martin, semblent gagner en popularité et inspirer davantage confiance que les évêchés. Ces structures bénéficient vraisemblablement d’un report des dons, au détriment du denier diocésain.
– La situation vous semble-t-elle irrémédiable ou entrevoyez-vous des solutions à celle-ci ?
Non, il n’y a pas lieu de désespérer ! Les diocèses partent de loin en matière de gestion financière, mais des solutions existent. Si le pape François a laissé un enseignement qui peut être retenu, c’est la nécessité d’impliquer les laïcs dans la vie de l’Église. Au lieu de les faire entrer dans le chœur des églises, ils pourraient aider dans les affaires financières.
De nombreux anciens chefs d’entreprise et cadres compétents pourraient mettre leur expertise au service des diocèses.
A côté de cet aspect technique, un renouveau de la foi catholique en France est indispensable et pour cela il faut non seulement de saints prêtres mais aussi de bons évêques et plus de pratiquants.
– Le succès des pèlerinages, notamment celui de Chartres, et la hausse du nombre des baptêmes réjouissent légitimement nombre de catholiques. Pensez-vous qu’il s’agisse d’un mouvement de fond ou d’un simple épiphénomène circonstanciel ?
Le pèlerinage de Chartres témoigne de la vitalité des traditionalistes en France et constitue une réussite indéniable. Au-delà de la Tradition, une progression du nombre de baptisés est observée partout en France, ce qui représente un motif d’espoir. Cependant, pour ce qui concerne notre étude sur le denier de l’Église, les autorités ecclésiastiques françaises font face à un double défi : faire la paix avec les traditionalistes et les conservateurs pour retrouver une partie des dons de leurs fidèles, et transmettre une culture du don aux nouvelles générations, qui n’ont pas toujours les moyens de leurs aînés dans un contexte économique précaire.
Liberté Politique : https://www.libertepolitique.com/
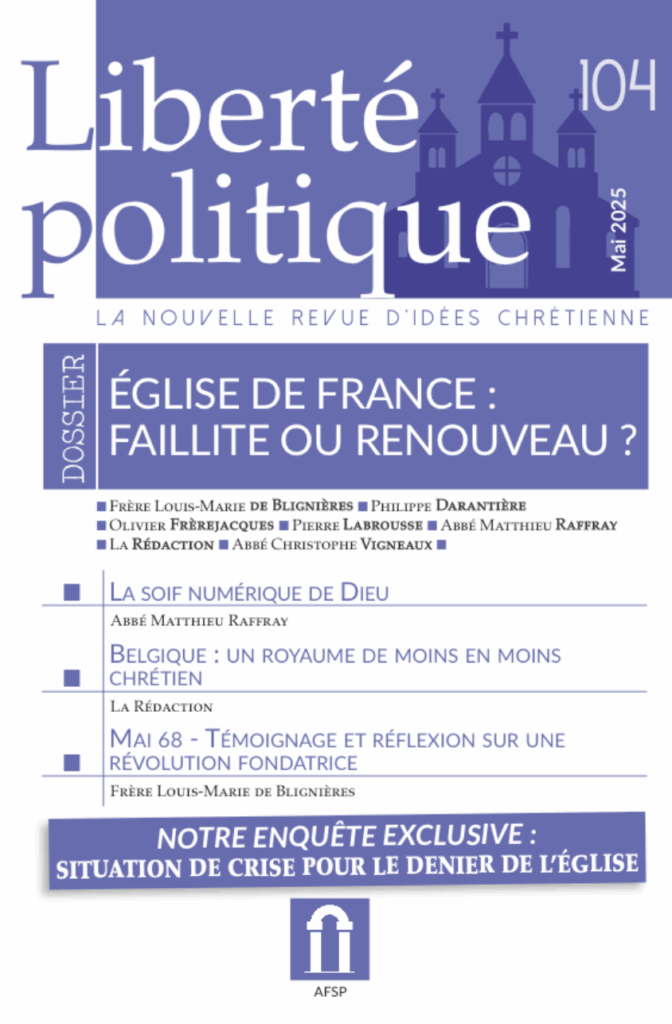

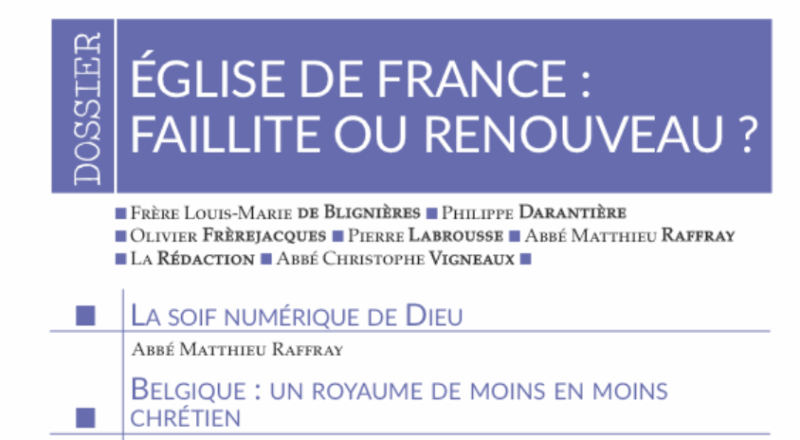


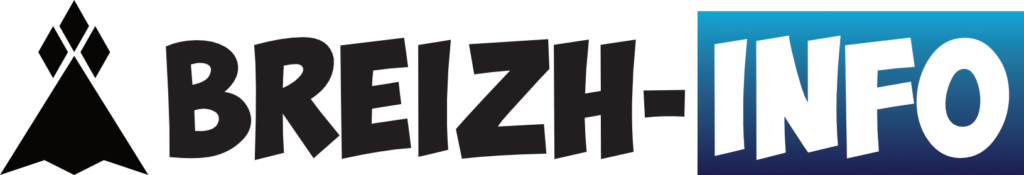

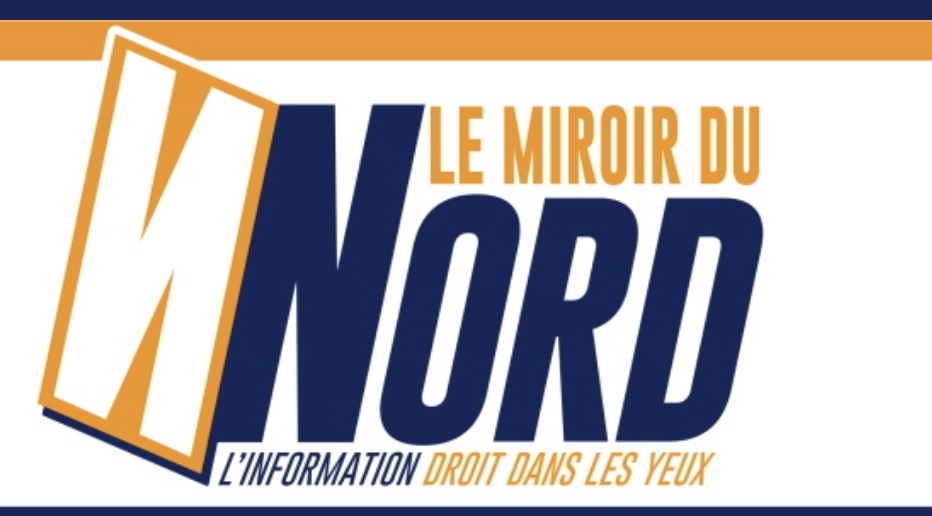

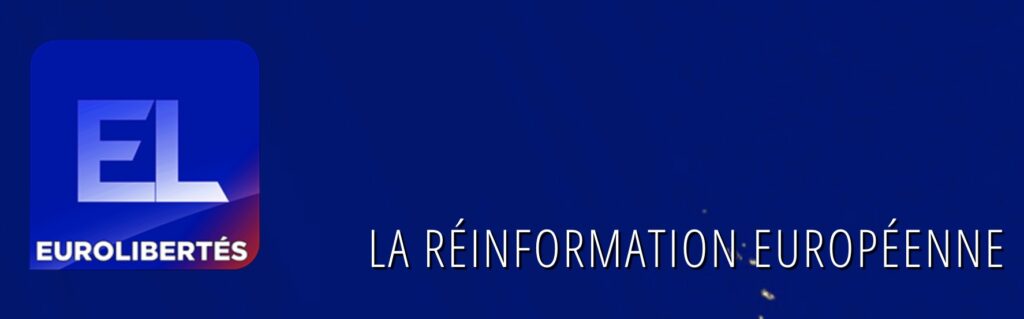
Chez moi, l’ « occupation » dominicale de l’église, c’est: messe du samedi soir avec le curé diocésain en titre (de nationalité étrangère) et nef souvent à moitié pleine avec nombre de têtes grises et messe dominicale avec un abbé de la Fraternité Saint-Pierre ( supportée jusqu’à maintenant par l’évêque du lieu) et nef pleine de familles avec moult enfants de tous âges (avec autel « retourné », enfants de chœur, chants grégoriens, etc.). Et le montant des quêtes ne sont pas du tout les mêmes…