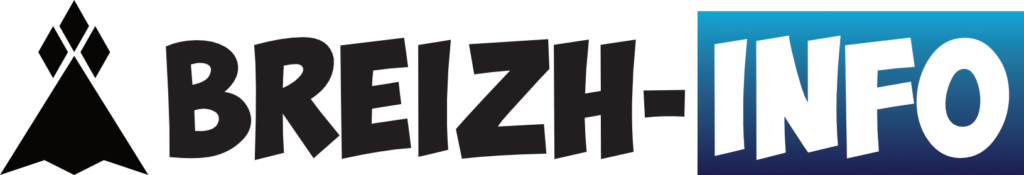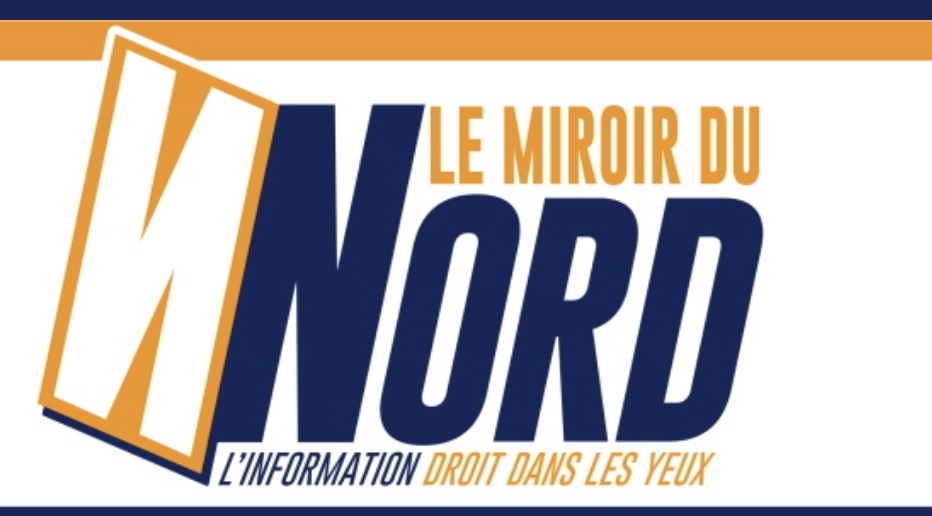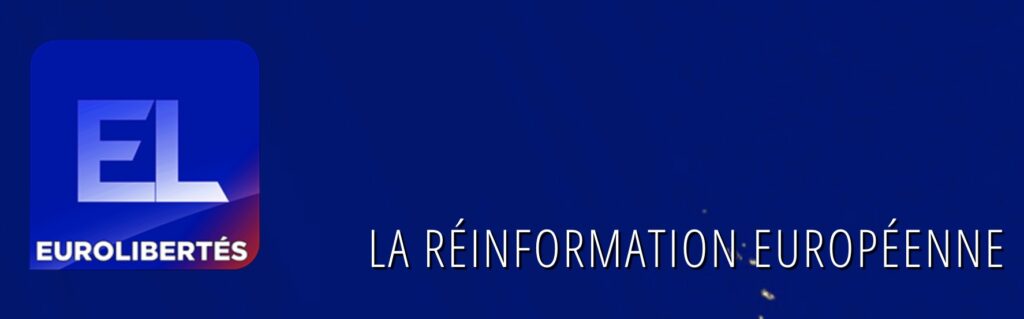Cette année, la quatrième semaine de septembre a été marquée, pour les catholiques, par ce que l’Église appelle « les Quatre-Temps d’automne ». Cependant, bien peu parmi nos compatriotes savent encore à quoi cette expression correspond.
Selon l’encyclopédie catholique Théo, les Quatre-Temps étaient, autrefois, des périodes de trois jours de pénitence et de jeûne (mercredi, vendredi et samedi) situées respectivement après : le 3e dimanche de l’Avent, le 1er dimanche de carême, le dimanche de la Pentecôte et le 17e dimanche après la Pentecôte. L’encyclopédie ajoute que l’origine des Quatre-Temps est très lointaine et mystérieuse, et qu’elle est probablement une reprise de célébrations païennes marquant les semailles, les moissons et les vendanges.
Dans la deuxième édition de son Dictionnaire de théologie publiée en 1831, l’Abbé Bergier définit les Quatre-Temps comme un jeûne qui s’observe au commencement de chacune des saisons de l’année. La coïncidence avec les saisons était donc affirmée en même temps que l’observance du jeûne considéré comme une mortification méritoire. L’Abbé Bergier souligne l’antiquité des Quatre-Temps en prenant pour référence des sermons du pape Saint-Léon qui en parlait « non comme d’un usage nouveau, mais comme une tradition apostolique ».
L’Abbé Bergier place les Quatre-Temps du printemps au commencement du carême, celui de l’été à la Pentecôte, celui d’automne au septième mois ce qui correspond à septembre sans davantage de précision et celui d’hiver au dixième mois qui correspond à décembre, l’année débutant au mois de mars dans l’Antiquité. Il ajoute que Saint-Léon était persuadé qu’il s’agissait d’une imitation des jeûnes de la synagogue, mais précise que « il n’y a point de preuve que les juifs aient fait trois jours de jeûne au commencement de chaque saison ». L’Abbé Bergier indique qu’on pourrait conjecturer que les Quatre-Temps ont été institués par opposition aux folies et aux désordres des bacchanales, « que les païens renouvelaient quatre fois l’année ».
Jusque dans la première moitié du XXe siècle, les missels affirmaient que la liturgie chrétienne avait retenu les sentiments et les pensées des Israélites qui célébraient les moissons, les récoltes et les vendanges. Mais ils affirmaient aussi que la liturgie chrétienne se les était appropriées pour célébrer les réalités nouvelles accomplies par le Christ et vécues par le nouveau peuple de Dieu. « Joie et pénitence s’unissent ainsi en ces Quatre-Temps, jours d’actions de grâces et de purification ».
Aujourd’hui, on ne songe plus à faire remonter les Quatre-Temps aux temps vétérotestamentaires ou même aux temps apostoliques, et c’est à Rome qu’on en cherche l’origine. Ainsi, certains y voient la solennisation du jeûne hebdomadaire des mercredis et vendredis, avec un prolongement le samedi. Initialement, on aurait connu Trois-Temps et non Quatre en observant les jeûnes du 7e mois et du 10e mois, ainsi que le jeûne de la Pentecôte ensuite appelé jeûne du 4e mois. C’est avec le Sacramentaire gélasien qu’apparut plus tard le jeûne du 1er mois (mars). Grégoire VII et Urbain II fixèrent définitivement le calendrier des Quatre-Temps.
D’après les documents qui subsistent, chacun des Quatre-Temps possédait et possède encore des formulaires qui lui sont propres : les Quatre-Temps de septembre gardent des références agricoles ; les Quatre-Temps de Pentecôte également ; les Quatre-Temps de l’Avent évoquent la proche venue du Christ ; enfin, les Quatre-Temps du Carême ont abandonné les références agricoles au profit de lectures quadragésimales, fondées sur l’observation des commandements et la sanctification que Dieu accorde à son peuple.
Prières et cycles des saisons
Les Quatre-Temps sont donc des temps de prière et de jeûne, coïncidant avec le cycle des saisons. A la fin du Moyen-âge, ils étaient devenus des fêtes d’obligation, et le sont restés jusqu’à la réforme qui a suivi le Concile Vatican II, à l’issue de laquelle ils ont pratiquement disparu de la pratique catholique. Pourtant, Saint-Léon qualifiait les Quatre-Temps « d’exercices officiels de l’Eglise » qui font appel au « peuple chrétien » en tant que peuple, ce qui les distingue des jeûnes et prières privés. A ce titre, ils bénéficient d’une « présence spéciale » du Christ médiateur, qui leur conférait alors une fécondité spirituelle particulière.
Peut-être l’Eglise catholique retrouvera-t-elle le sens de la liturgie associée au rythme saisonnier, et peut-être instituera-t-elle de nouveau les Quatre-Temps comme des fêtes d’obligation ? Une telle décision pourrait utilement accompagner le renouveau dont la foi catholique a de toute évidence grand besoin, et offrir aux catholiques, considérés comme peuple de Dieu, la présence très particulière du Christ médiateur telle que décrite par Saint-Léon.
André Murawski
Le Nouveau Présent a besoin de vous, faites un don, chaque euro compte!