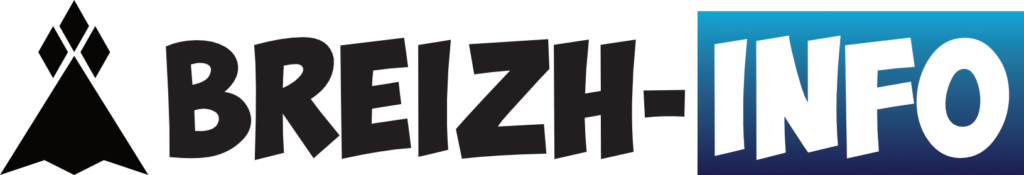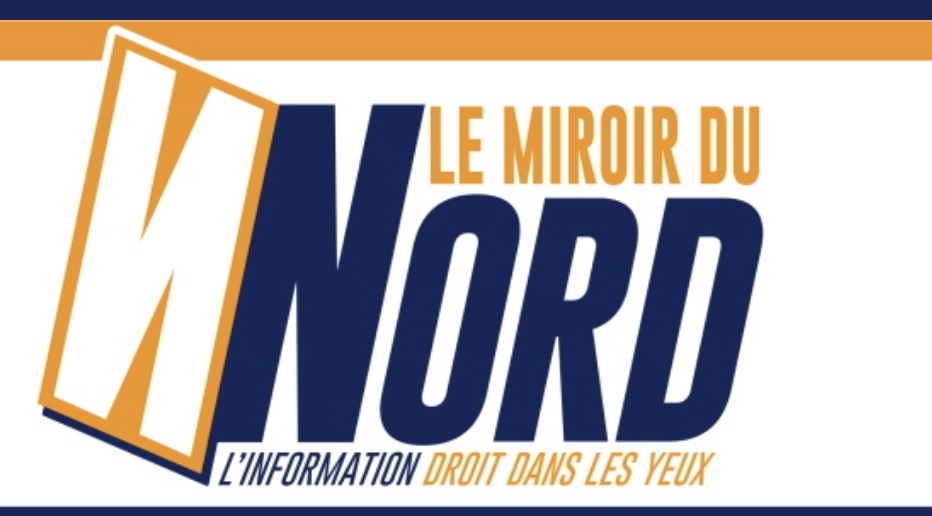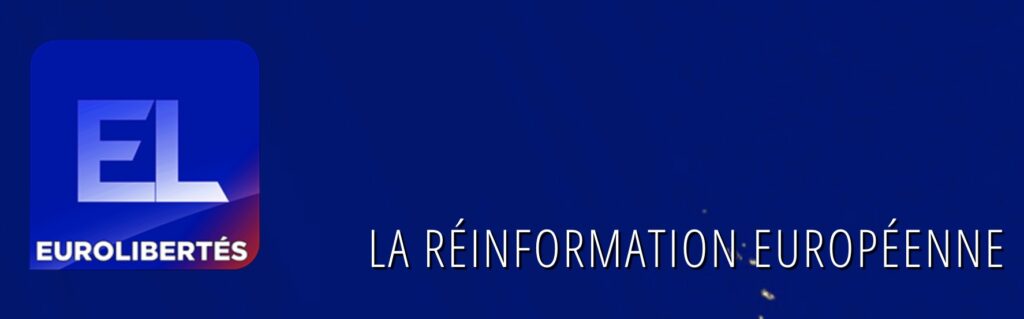L’apartheid existe aussi en Europe, aux dépens d’Européens, mais nul ne s’en soucie. Fallait-il une photographe sud-africaine pour capter la détresse des Serbes du Kossovo-Métochie prisonniers de minuscules enclaves dans ce qui fut le foyer de la nation serbe avant la tragédie du Champ des Merles en 1389 et l’invasion turco-musulmane qui en découla ?
J’ai connu en 1965 le Kossovo qui, pour moi qui venais pourtant d’Algérie, constituait le comble du sous-développement : une contrée délibérément abandonnée par la Yougoslavie communiste de Tito aux Albanais — Shkipetars — voisins. Mais les Serbes formaient encore près de la moitié de la population. Ils ne sont plus que 5000, selon Arnaud Gouillon, fondateur à 19 ans, en 2004, de la très dynamique association Kossovo Solidarité (1) qui ne se contente pas d’envoyer de l’argent à cette population résiduelle mais lui fournit matériel médical et agricole, semences et même bétail, creuse des puits, aide à la construction d’écoles et à la reconstruction des édifices religieux dont 160 ont été incendiés depuis les années 90 du siècle dernier et la mainmise albanaise.
Le Kossovo compte quelques-uns des plus beaux monastères orthodoxes mais ce ne sont pas Gračanica ou Visoki Dečani que Katharine Cooper, récipiendaire de nombreux prix, a mitraillés. De ses séjours dans cette contrée déshéritée, elle a rapporté des clichés non seulement très beaux dans leur austérité (le noir et blanc domine) mais aussi profondément émouvants : mères serrant leur enfant sur leur cœur, un pope ayant tombé la soutane pour rafistoler sa petite église, vieillards avec leurs chèvres, paysans dans leur champ, maçons à l’œuvre.
Accueillie hélas trop brièvement dans l’Espace Georges Bernanos géré par l’église St-Louis d’Antin à Paris, cette expo a donné lieu le 14 octobre à une table ronde présidée par Pierre-Alexandre Bouclay, directeur de Radio-Courtoisie, et à laquelle participèrent, outre Mme Cooper qui parle un français parfait, notre confrère du Figaro Jean-François Buisson et bien sûr Arnaud Gouillon, qui évoquèrent les responsabilités de l’OTAN mais aussi de l’Europe, France comprise, dans la sauvage purification ethnique qui se poursuit, en toute impunité, à 1500 kilomètres de nos frontières.
Quand Sargent « éblouit Paris »
Le contraste était cruel pour qui venait d’admirer au musée d’Orsay la très complète — près de cent œuvres — et elle aussi très belle exposition Sargent (2).
De nationalité américaine mais né et éduqué à Florence avant de passer les deux tiers de sa vie en Europe, John Singer Sargent (1856-1925) frappe par son aisance et sa virtuosité picturales, passant des copies de Velasquez, son peintre préféré avec le Tintoret, à la peinture mondaine, de tableautins pris sur le vif à l’aquarelle aux très grands formats réclamés par ses riches clients, sans jamais toutefois sacrifier à l’académisme, au contraire de son rival italien, Giovanni Boldini.
Un croquis en couleur de Judith Gautier, la fille de l’illustre Théophile, se débattant dans le vent, annonce le fauvisme ; un petit portrait brossé en une après-midi de son amie d’enfance Violet Paget, dite Vernon Lee, est criant de vie comme de vérité et une plongée monochrome dans une fosse d’orchestre contraste avec les normes de l’époque. Tout comme le portrait en très grand format — mais en robe de chambre écarlate ! — du jeune Dr Pozzi, plus tard commensal de Sarah Bernhardt et de Proust, avec lequel Sargent présente d’ailleurs une certaine parenté : leur connaissance intime des techniques des temps anciens leur permettant de s’affranchir de la querelle des anciens et des modernes.
Une autre découverte, à ne pas rater.
Camille Galic
- https://www.solidarite-kosovo.org
- Jusqu’au 11 janvier 2026. https://www.musee-orsay.fr/fr/agenda/expositions/john-singer-sargent-eblouir-paris