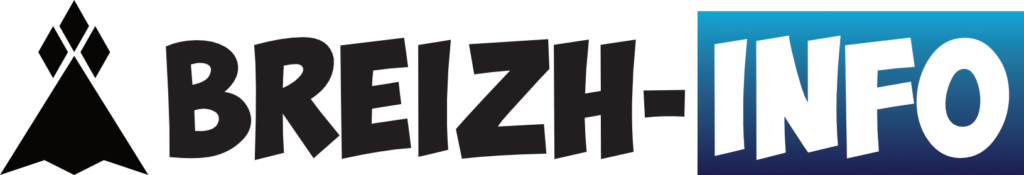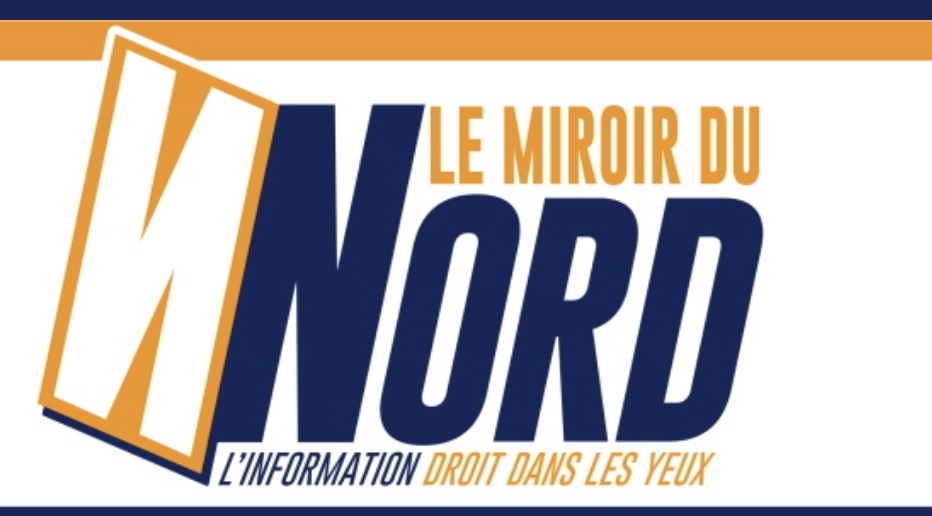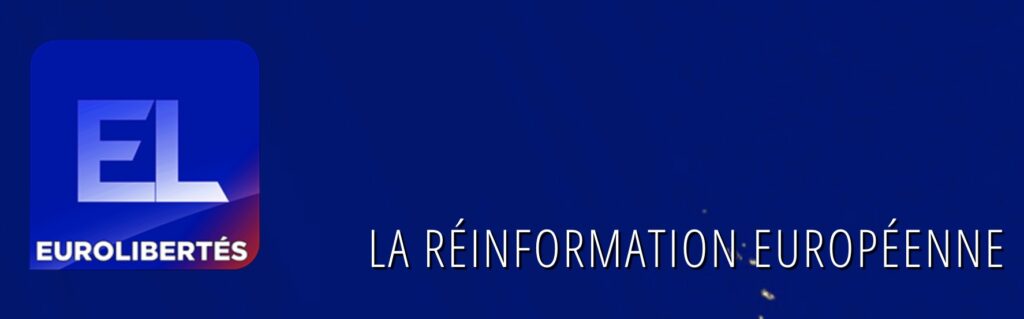C’est un peu inattendu, mais trente ans après le référendum de 1995 sur la question de l’indépendance — perdu par quelques milliers de voix malgré l’appui de 60 % des Canadiens français — la question nationale reprend toute la place au Québec, ravivant une flamme que plusieurs espéraient éteinte.
L’enjeu est simple : faire du Québec un pays à part entière afin que l’Amérique française puisse survivre, évitant ainsi une assimilation à la sauce cajun.
Les raisons de ce réveil sont multiples, mais elles sont d’abord et avant tout liées à l’identité et à l’immigration de masse subie depuis des années. Le parti actuellement au pouvoir à Québec, la Coalition avenir Québec de François Legault, mise depuis 2018 sur la question identitaire pour se maintenir au pouvoir. Promesses de réduire l’immigration, de défendre le fait français, d’instaurer une constitution… Legault a compris que le vent avait tourné et que, plus que jamais, les Québécois en ont ras le bol des politiques de submersion migratoire imposées par le Canada. Mais les demi-mesures de la CAQ ont finalement pavé la voie à ceux qui réclament l’indépendance comme unique moyen de préserver l’identité québécoise.
Le parti souverainiste historique, le Parti québécois (PQ), a donc le vent dans les voiles. Premier dans les intentions de vote et dans les dons, il se prépare aux prochaines élections et son programme a évolué : après le référendum de 1995, il s’était engagé dans une logique de « bonne gestion de la province ». Désormais, il vise clairement l’indépendance. Pour nombre de Québécois, conscients de l’impact démographique de l’immigration, il s’agit de la dernière chance de devenir un pays. C’est l’indépendance ou la louisianisation.
Seulement, par démocratisme, le PQ de Paul Saint-Pierre Plamondon veut s’engager dans la voie référendaire. Un choix d’autant plus étonnant que les révélations s’accumulent sur les irrégularités du scrutin de 1995. Récemment, Sergio Marchi, alors ministre de l’Immigration, a admis avoir accéléré le traitement des demandes de citoyenneté avant le référendum afin d’augmenter le nombre d’électeurs favorables au camp du non (statu quo). Peut-on vraiment croire que, cette fois-ci, le camp fédéraliste jouera franc jeu? D’autant que, contrairement à 1995, où le Québec jouissait d’appuis tacites en France, il est désormais isolé, sans relais. Une « élection référendaire », consistant à appliquer le programme pour lequel le Parti québécois aurait été élu, serait nettement plus réaliste, stratégiquement parlant. Surtout que le Québec n’a jamais signé la Constitution qui le régit.
Dans tous les cas, l’année 2026 risque d’être décisive.
Rémi Tremblay