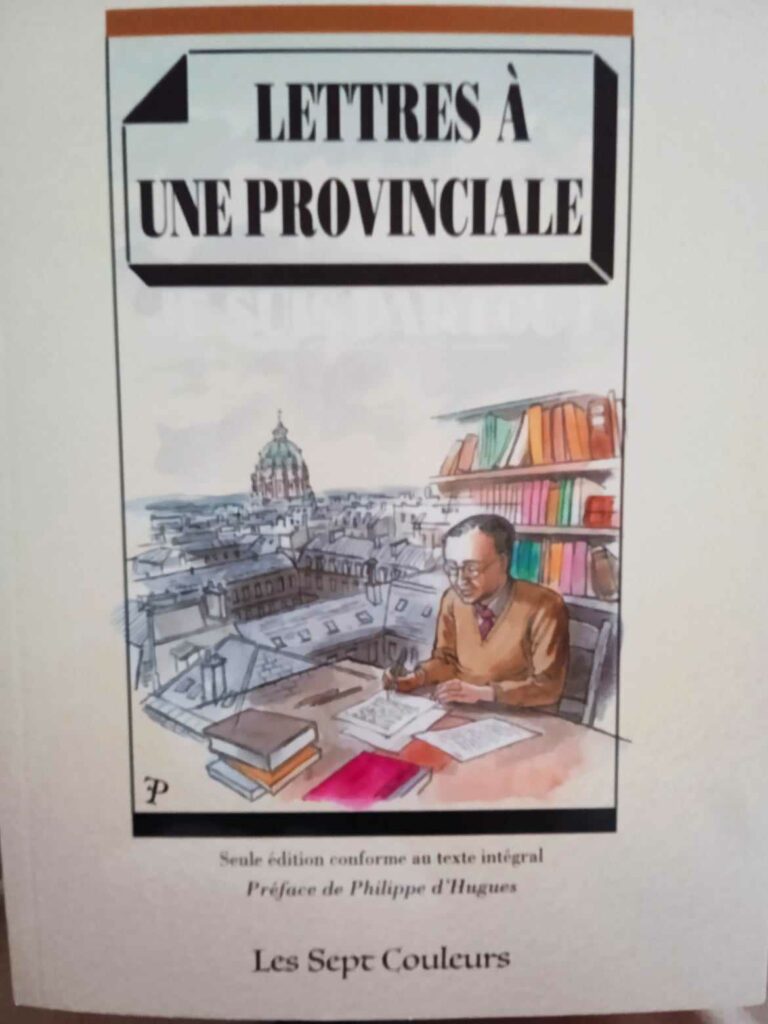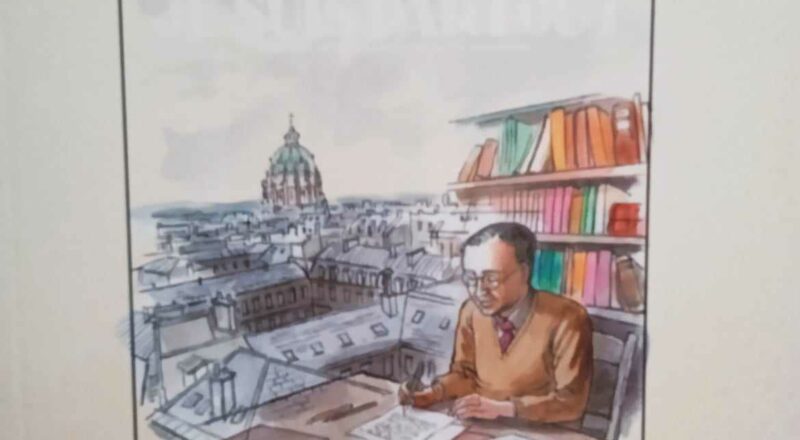Pardonne-moi, cher lecteur, de te parler à nouveau de Robert Brasillach. Bien entendu l’auteur de Comme le temps passe ne constitue pas à lui seul l’alpha et l’oméga de la littérature française. Mais à la différence de la plupart des autres écrivains du XXe siècle, grands ou petits, Brasillach a subi et subit toujours, quatre-vingts après sa mort, un injuste ostracisme.
Aucun écrivain moderne ne mérite donc, davantage que lui, d’être soutenu, promu, diffusé. Imaginez par exemple le boycott d’Aragon ou d’Eluard pour leur apologie obscène de la Guépéou ou du stalinisme. Imaginez la même chose, dans le domaine de la peinture, à l’égard de Picasso ou de Fernand Léger. Non seulement ces auteurs et artistes-là ne furent ni inquiétés ni boudés, mais il est possible de soutenir qu’ils ont dû en grande partie leur sortie de l’anonymat et leur carrière, leurs succès, à leur appartenance au camp stalinien.
Pour sa part, Brasillach a payé – et à quel prix ! – son engagement dans le camp d’en face. Néanmoins tout est encore fait pour le maintenir dans le néant littéraire. Pour ma part je vois dans ce constat un motif non négociable pour ne jamais laisser passer une occasion de le faire découvrir à ceux qui ne l’ont pas lu, ou de redonner aux autres l’envie de le lire. Précisément cette occasion se présente sous la forme d’un inédit de prés de 400 pages, publié aux Sept couleurs, la maison d’édition lancée récemment par l’association des Amis de Robert Brasillach.
Artifice littéraire
Cet inédit s’appelle Lettres à une provinciale.
Comment ? Brasillach aurait écrit un ouvrage de ce volume, resté totalement inédit ? L’édition de ses « Oeuvres complètes » (Editions de l’âge d’homme, 1963-1966) serait donc incomplète ? La vérité n’est pas si simple. Ces textes furent publiés dans l’hebdomadaire Je Suis Partout entre 1936 et 1940, partiellement repris dans une édition commentée, et néanmoins incomplète, en 1983. Mais c’est à peu près tout.
La forme qu’avait donnée Brasillach à sa série d’articles – des lettres fictives à une amie prénommée Angèle, vivant en province, et censée ne pas partager ses goûts et ses opinions – semblait exclure une reprise ultérieure, en un seul recueil, de ces textes.
C’est d’ailleurs l’un des artifices littéraires les plus classiques. On sait que Brasillach s’est amusé à les explorer tous, en particulier dans son livre intitulé Les sept couleurs. Les échanges de lettres entre Catherine et Patrice constituent l’un des sept procédés d’écriture utilisés dans ce roman. Mais écrire un roman sous forme de lettres (sans réponse publiée) à une amie est un exercice plus difficile encore, surtout quand ces lettres ont pour véritable but de nous commenter l’actualité politique, culturelle et artistique de la semaine écoulée.
La toute récente édition des Lettres à une provinciale relève ce défi.
Philippe d’Hugues, qui est, entre autres qualités, l’un des biographes de Brasillach, nous explique que cet ouvrage doit bien être considéré comme le trente-deuxième livre du poète fusillé, un livre caché dans les pages de Je Suis Partout, en quelque sorte. Ce n’est pas un simple recueil d’articles, mais « un véritable ouvrage, construit, homogène, avec unité d’action et de personnages ».
Pourquoi Angèle ? Philippe d’Hugues nous donne l’explication : en 1900, Gide avait publié un recueil intitulé Lettres à Angèle. 1898-1899. « Angèle, nous dit Philippe d’Hugues, c’est un pied de nez à André Gide, prolongeant ceux du khâgneux facétieux (…), qui avaient fâché le vieux bonze devenu pontifiant ». Quant au titre donné à cette édition complète, Lettres à une provinciale, c’est pour le coup un hommage à Giraudoux, dont le roman Provinciales, parut en 1909, et manqua de peu le Goncourt.
Loin de rendre l’ouvrage rebutant, la forme littéraire épistolaire donnée à ce livre en facilite la lecture, lui donne un ton primesautier, plaisant, comme s’il s’agissant en effet d’un « roman-roman ». Cette Angèle, on finit par souhaiter qu’elle réponde à Brasillach.
Personnellement, si j’avais été Angèle, je ne me serais pas gênée pour lui dire par exemple qu’il me fatiguait un peu avec sa critique de quelques têtes de Turc, au demeurant insignifiants, tels Léo Lagrange (qu’il surnomme sports-et-Loisirs ou encore M. Loisirs), André Chamson, Jean Cassou, Marie Bell, Romain Rolland, Jean Lurçat, Langevin, le philosophe Alain, Jean Guéhenno, Malraux ou Aragon, tous plus ou moins inféodés au Front populaire et furieux va-t-en-guerre concernant la guerre d’Espagne. Brasillach s’en donne à cœur joie, comme à Guignol, pour moquer les bien-pensants de l’époque, tenter de convaincre son amie Angèle. .
Quant à Léon Degrelle, dont Brasillach fait grand cas, ayant commencé sa « correspondance » peu avant son reportage en Belgique et sa mémorable rencontre avec le chef de REX, je sais bien qu’il n’a pas tenu les promesses de son tonitruant engagement politique, même si je fais partie des lectrices admiratives de son courage sur le Front de l’Est, si bien raconté dans ses souvenirs. Mais je reconnais volontiers que mon jugement est un peu trop facile, quatre-vingts ans plus tard, alors que je connais la fin de l’histoire !
« Nauséabondes années trente » ?
Ce qui m’a intéressée, aussi, dans ces Lettres à une provinciale, c’est la façon dont Brasillach évoque Hitler : le risque de guerre se précise, le führer est imprévisible, et le pacte Ribbentrop-Staline va concrétiser la menace. Brasillach n’est dupe de rien, ni des rodomontades des dictateurs, ni des lâchetés et des démissions des hommes du « système ». De ce point de vue, sa critique est pertinente, lucide.
Le livre est bourré de d’apartés, d’anecdotes. Il nous parle par exemple, pour s’en moquer, d’une pièce fasciste donnée en 1935 et intitulée Vie d’un camion pendant la marche sur Rome. J’avoue que cela m’amuserait d’en lire le texte.
Page 29, je relève cette phrase, à propos de « la question religieuse » : Brasillach évoque le fait que « notre pays, où vivent en excellent voisinage les catholiques, les protestants et les juifs, est le plus tolérant qui soit ». Lu en 2023 sous la plume d’un écrivain qui, quand il est cité, est systématiquement qualifié d’antisémite, uniquement pour en réduire le génie, cela transforme quelque peu notre vision des années 1930. Actuellement on nous nous parle au contraire, à longueur de journées, des « nauséabondes années trente qu’il ne faut plus revoir en France ». Il me semble pourtant, à lire Brasillach, que les rapports entre personnes de religions différentes vivant sur le territoire français, étaient en fait bien meilleurs qu’aujourd’hui. La presse ne publiait pas, chaque jour, la liste des nouvelles victimes de l’intolérance religieuse.
Et Brasillach, quand il se moquait des thuriféraires du Front popu, le faisait avec esprit, avec humour, avec ironie, parfois, mais pas avec haine. On sent même parfois poindre par exemple de l’admiration pour Malraux, ou de la sympathie pour Léo Lagrange, un Léo Lagrange qui trouva la mort au combat en juin 1940. Ce qui montre au passage que Brasillach avait du flair pour identifier talent ou courage, même chez ceux dont il ne partageait pas les convictions « républicaines-et-antifascistes ».
Dire la vérité
En janvier 1940, parait l’une des dernières lettres à Angèle, le tout constituant donc ces Lettres à une provinciale. Dans cet ultime message, Brasillach explique qu’il est important de dire la vérité aux Français et qu’il faut savoir se mettre à la place de ceux à qui l’on parle. Le conseil était plein de bon sens. Nos dirigeants et faiseurs d’opinion actuels devraient en prendre de la graine.
Mais ces mots de l’auteur de Notre avant-guerre nous font aussi comprendre ce qui le sépara, à partir d’août 1943, de Je Suis Partout. Ce n’était pas de la lâcheté ou de l’opportunisme, c’était une fidélité à cette ligne de conduite, exposée, donc, dès 1940, dans ses lettres à Angèle.
Inutile de vous confirmer que ces textes forment un livre précieux, pour ne pas dire essentiel, à la connaissance de son auteur. Bravo aussi au rédacteur des notes de bas de pages qui permettent de resituer personnages et évènements, voire de comprendre des mots et des expression passés de mode. Ce travail-là, fastidieux, bien entendu, est trop souvent absent d’ouvrages publiés ou réédités très longtemps après qu’ils aient été écrits.
Madeleine Cruz
Lettres à une provinciale, Ed. des Sept couleurs, 374 p., préface de Philippe d’Hugues, illustration de couverture de Chard. A commander à l’association des amis de Robert Brasillach. 28€.