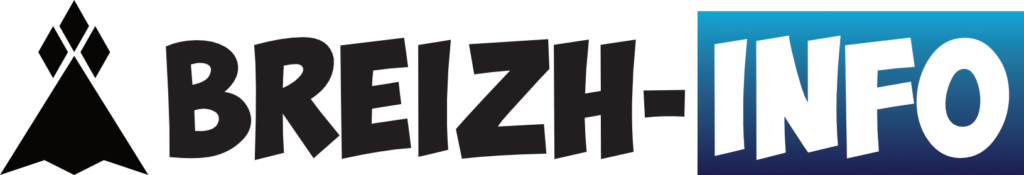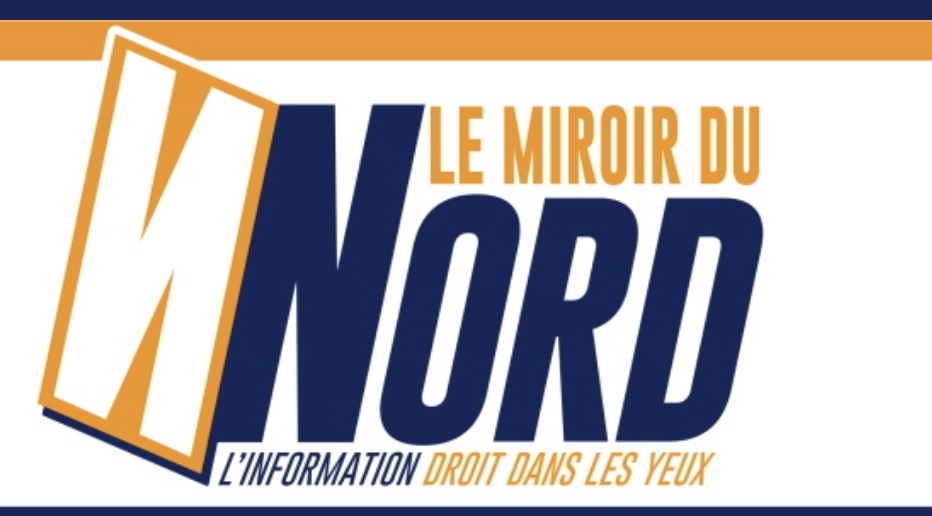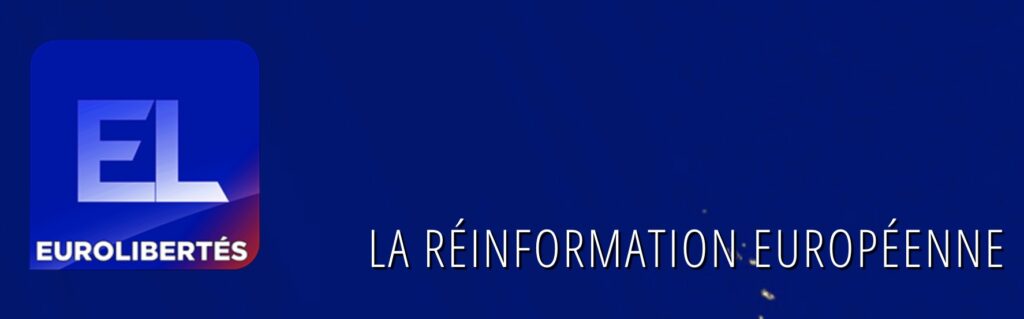La cité ressemble à s’y méprendre à un diorama de l’avant-cinéma ou à une ville-jouet pour ferromodélistes forcenés, appelés aussi ferrovipathes ou modélistes ferroviaires (mon bon ami Claude Nobs, inventeur du Montreux Jazz Festival, en faisait partie, lui qui avait passé toute sa sage enfance à regarder passer les trains en gare de Territet sur les bords du Léman, lac saupoudré pour toujours de ses cendres et de celles de Micka, ô si gentille Mickala, sa chienne).
La commune est engoncée dans l’estuaire sablonneux et entourée de haies protégeant de gras et humides prés salés où paissent agneaux et moutons en grand cheptel. On peut rencontrer ces ovidés paisibles, grégaires et obstinés surtout si l’on s’en vient depuis le nord-est, c’est à dire par Le Crotoy ou Crécy-en-Ponthieu de si triste mémoire. Car c’est ici que commença la guerre de Cent ans lors d’une bataille horrible, où sévirent après l’assaut fatal, brûleurs, écorcheurs et porchers, sortes de terribles prédécesseurs des nettoyeurs de tranchées ou de creutes picardes.
A Crécy, « L’ordre anglais terrasse la furie française, l’épée pliant sous l’arc. Au cœur d’un royaume en flammes, Édouard III d’Angleterre, encerclé, affamé, choisit la colline de Crécy pour livrer bataille et déploya ses archers en croissant. S’il fait face à une coalition supérieure en nombre, les Génois tombent cependant sous les flèches, le roi de Bohême meurt en héros, et les chevaliers français s’empalent sur les rangs anglais tandis que Philippe VI de Valois est acculé à la fuite. » Histoire générale de France depuis les temps les
plus reculés jusqu’à nos jours. Abel Hugo (Tome 4). 1841.
A Saint-Valéry (prononcez sainvalri, comme chez moué à Sainvalri en Caux voisin), on accède tout d’abord à un parking gratuit sur la rive droite de la Somme. Il est entretenu à la six-quatre-deux, cerné de broussailles et tout garni de pierres pleines de méchanceté sur une terre avaricieuse, âpre et rogneuse qui n’obéira jamais qu’à force d’être torturée puis aplanie. Est bien fou du cerveau qui veut s’aventurer plus loin en automobile afin de la parquer; pour la bonne raison que le village regorge de monde dès que le ciel est clair ou que la saison et l’heure demeurent propices à la promenade. Bouchon garanti.
L’arrivée en gare.
Il nous faut patienter au passage à niveau dont la barrière est en berne. La locomotive arrive, quel tableau ! Et quelle surprise… C’est une sorte de machine à vapeur, toute petite, pimpante, fumante et colorée à souhait, qui tire quelques wagons vides. Deux « roulants » à casquette, pantalon bleu de travail, bretelles et chemise à carreaux, chenus et débonnaires, nous prêtent leur salut, rendons leur ! Bientôt nous arrivons à la gare ferroviaire, menue, râblée et tout en bois comme un chalet vaudois. Devant la bicoque sont exposées de très belles voitures de voyageurs de troisième, de deuxième et de première classe et des fourgons à bagages suisses.
Le chemin de fer louvoie entre une rangée de belles maisons datées, collées les unes aux autres, de hauteur différente, presque toutes chapeautées d’ardoises; et le fleuve pacifique qui termine sa course dans la Manche à l’extrémité d’un large delta (qui n’a rien à voir avec l’OAS). Les Romains appelaient la Somme « Samara » en s’appropriant sans autre forme de procès l’étymologie gauloise : samo (tranquille) et ar (rivière ou vallée). Des voiliers, trimarans, cotres et vedettes sont à l’ancre dans le port de plaisance.
Les arbres plantés à raison tout le long du chemin dispensent aux promeneurs l’abri nécessaire et suffisant; comme professent les matheux. Les flâneurs, pareils à des compagnies de fourmis sont en quête de récompense, qui est la même pour tout homme et pour tout fleuve… Voir et chérir la mer, encore un peu loin cependant. La promenade est avenante, assez longue. A main gauche, de belles et fortes maisons de caractère se succèdent, protégées par des clos d’arbres hauts, en forme de boules ou en forme de pinceaux, comme on dit dans l’armée de terre. A main droite coule le fleuve propice aux rêves, aux songes, aux souvenirs. Faut-il qu’il m’en souvienne, l’amour venait toujours après la Somme… après la Seine, après le Rhône, après la Saône et tutti quanti… Ils s’écoulent et ne tarissent pas. Les poètes aiment les eaux vives, Lamartine, Brassens, Gripari et Brasillach, la Seine; la Meuse pour Charles Péguy, le Rhône pour Mistral, le Rhin pour Alfred de Musset et Apollinaire, la Louère pour monsieur Jehan de la Fontaine…
Présence de Jehanne
Nous arrivons au bout de la ville. Un chemin escarpé, un escalier fastidieux nous mènent à ce que l’office de tourisme appelle la « cité médiévale ». Il faut bien constater qu’entre toutes les villes côtières picardes, Saint-Valéry est celle qui a le patrimoine historique le plus riche. Et pour cause ! La petite capitale du Vimeu a grandi autour de la plus ancienne abbaye de Picardie que fonda en 611 le moine d’origine irlandaise Walrik, Gualaric, Gwalaric, francisé sous le forme de Valéry qui évangélisa la région en suivant saint Colomban de Luxeuil dont avons déjà parlé (Nouveau Présent. 21/10/2024). La ville haute possède encore quelques fortifications, des rues pavées menant à la porte Guillaume du XIIème siècle sous laquelle aujourd’hui, un élève sous-officier, en grande tenue, fait immortaliser son mariage par un photographe averti. Il parait que les deux tours existaient déjà du temps du Conquérant, en 1066, quand il parti à la conquête de l’Angleterre, d’où le nom. Le monument est aussi appelé Porte Jehanne d’Arc en souvenir de son malheureux passage en la contrée.
En 1430, la Pucelle traverse la baie de Somme dans l’espoir de rencontrer le dauphin. Trahie, capturée, emprisonnée dans la ville, transférée au Crotoy par la suite, puis à Rouen. Jugée pour hérésie, elle sera brûlée par triple combustion afin que son corps soit réduit en cendres. Celles-ci furent ensuite dispersées dans la Seine, comme son cœur imbrûlé et intact, afin qu’aucun culte ne lui soit rendu. Peine perdue. De mon temps, quand Lecanuet était encore maire de Rouen, les fêtes johanniques se déroulaient en grande pompe populaire. Des marins en tenue singulière, genre pantalon à la zouave, jambières blanches et coiffés de bachis réglementaires à pompon (couleur bleu cerise) défilaient avec comme arme le FSA modèle 49/56 ou la mitraillette MAT 49 tout en fer noir que connaissent bien les anciens d’Algérie ou d’Indochine. Des majorettes en minijupe et bottes blanches, petits hauts rouges et fourragères d’or, ouvraient la marche en lançant leur bâton le plus haut possible au son des cuivres et des tambours. Maintenant que j’y pense, c’était cocasse… Certaines étaient mignonnes, d’autres vraiment plantureuses et grotesques, publicités vivantes pour la marque Olida aujourd’hui disparue. Des lansquenets véritables colosses, maniaient des drapeaux grands et lourds comme des tapis de châteaux. La foule applaudissait, ébaubie devant autant de force et de prouesses. La marche était fermée par des jeunes filles en fleur et des dames en habit normand traditionnel folklorique aujourd’hui délaissé et même oublié. Munies de paniers remplis de fleurs, elles marchaient, ces élégantes, depuis le lieu du bûcher et du crime, situé place du Vieux-Marché, jusqu’au pont Jeanne d’Arc, où elles balançaient à la gode, à l’ieau, aux flots de Seine, tous les beaux lys, coquelicots, marguerites, boutons d’or, bleus chardons de nos campagnes. Tout bézot, je ne comprenais pas qu’on sacrifiât ainsi ces joliesses que j’aimais tant récolter moi-même pour fleurir la maison ou le petit vase portatif placé sur le tableau de bord de nos automobiles, une Deux-chevaux, une Ami 6 puis une Ami 8 break, de la marque Levie André Citroën. J’ai grandi, j’ai compris… Et tous comprendront.
Au berceau de l’Enfant Honneur
On a vu deux fées apporter
Leurs présents pour l’Enfant Honneur :
Le courage avec la gaîté ;
À quoi, dit-on à la première,
Sert un présent comme le vôtre ?
Presque à rien, répond la première ;
À donner du courage aux autres.
L’autre, dit-on à la seconde,
N’est-il pas de trop pour l’Honneur ?
— Un enfant, répond la seconde
A toujours besoin d’une fleur.
Je passais au bord de la Seine un livre ancien sous le bras, le fleuve est pareil à ma peine…
Jeanne ! Au secours !
Franck Nicolle
Vous aimez lire le Nouveau Présent? Faites un don pour nous aider à continuer!